No CrossRef data available.
Article contents
Intérêts de l’application du concept canguilhemien de NORMATIVITE au champ de la psychiatrie
Published online by Cambridge University Press: 16 April 2020
Abstract
L’objet du travail est de montrer l’intérêt d’une application à la psychiatrie du concept de normativité, développé initialement dans le cadre général de la médecine par G. Canguilhem. Méthodologiquement, c’est une recherche de philosophie appliquée. La médecine recourt à diverses disciplines pour produire des déterminations à sa pratique, – d’où la terminologie plurielle et équivoque de « sciences médicales ». Il n’est donc pas illégitime, à certaines conditions, de produire une recherche philosophique sur la médecine. À partir d’une lecture de Canguilhem, nous avons tâché d’expliciter le concept de normativité en ce qui concerne la maladie dans sa dimension organique. Ce concept détermine la nature de la différence axiologique entre le normal et le pathologique. En introduisant les notions de valeur et de finalité, il se montre fécond à orienter la pratique clinique médicale, par-delà les objectivations scientifiques et technologiques. Nous avons proposé d’appliquer ce concept à la notion de maladie mentale. Les résultats de cette application montrent que la maladie mentale relève d’une même logique que celle de la maladie organique, ce qui permet de garantir la place de la psychiatrie dans le champ de la médecine. Néanmoins, cette logique n’opère pas dans le même contexte. À partir d’une même normativité, organisme et psychisme apparaîssent comme les deux modes d’individualisation de l’être humain : d’abord dans l’environnement naturel (champ de lois) par le caractère générique d’espèce, ensuite, dans un monde social et culturel (champ de normes) par le caractère particulier de la personnalité. De cette double détermination impliquant les rapports, répulsifs ou propulsifs, de l’individu normatif au milieu, il découle une définition plurivoque mais synthétique de la maladie et de la santé. La spécificité de la psychiatrie peut être alors précisée. Dans cette perspective, se dégage un programme de philosophie appliquée à la psychiatrie, à la médecine et à leurs rapports.
- Type
- Posters
- Information
- European Psychiatry , Volume 28 , Issue S2: Hors-série 1 – 5ème Congrès Français de Psychiatrie – Nice, novembre 2013 , November 2013 , pp. 88
- Copyright
- Copyright © European Psychiatric Association 2013



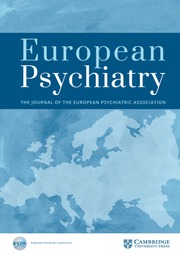

Comments
No Comments have been published for this article.