No CrossRef data available.
Article contents
Etudes sur la formation du droit humanitaire: Les idées humanitaires et le droit romain
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Abstract
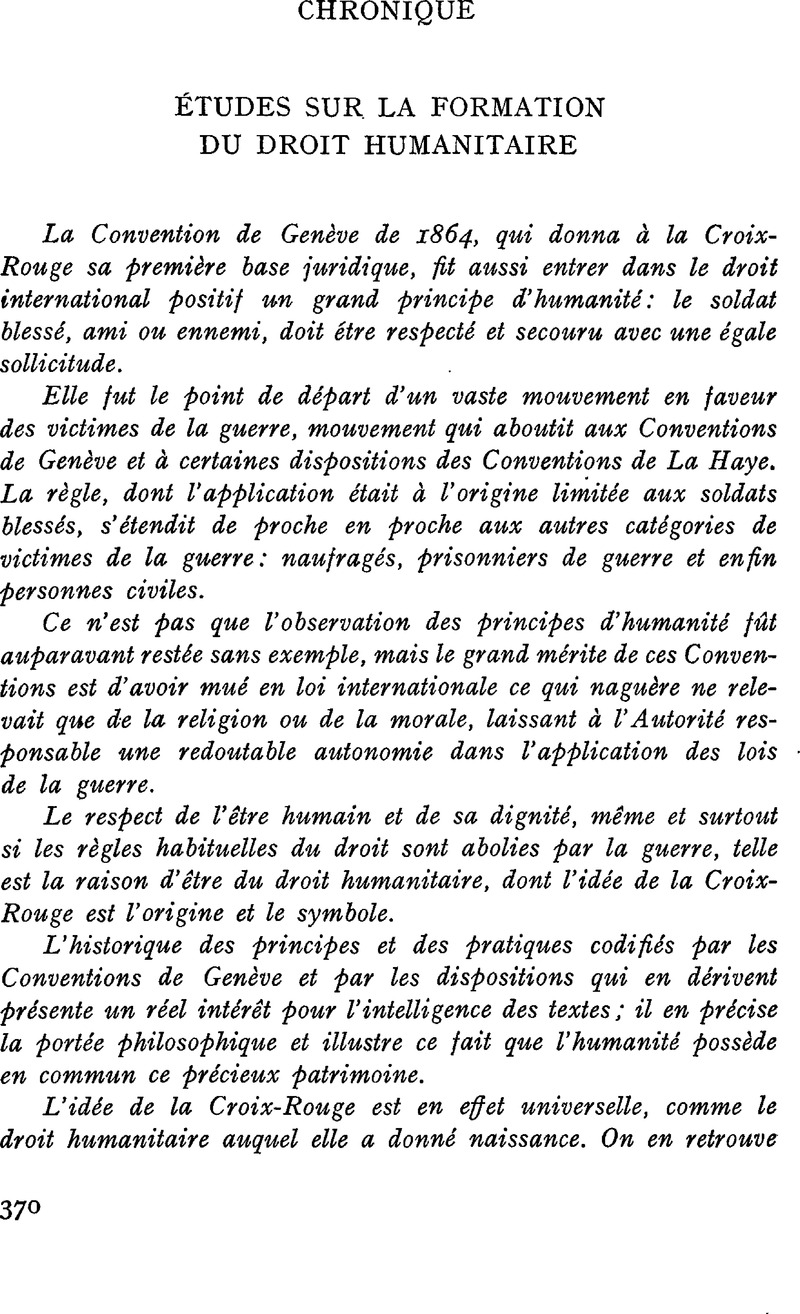
- Type
- Chronique
- Information
- Copyright
- Copyright © International Committee of the Red Cross 1951
References
page 372 note 1 Cf. Revon — Le droit de la guerre sous la république romaine, pp. 38 et ss.
page 372 note 2 Cicéron:De officis, I, II. — Remarquons que le mot « hostis » est à l'origine de termes d'un sens tout different:« hôte » en français et « guest » en anglais, le sens originel n'ayant été conservé que dans les dérivés:hostile, hostilités.
page 372 note 3 Pomponius:Hostes hi sunt qui nobis, aut quibus nos publice bellum decrevimus; cœteri aut latrones, aut prœdones sunt. L. 118, Dig. De Verb, signif., 50, 16.
ULPIEN:Hostes sunt quibus publice populus romanus decrevit vel ipsi populo romano; cœteri vero latrunculi vel prœdones appelantur. L. 24, Dig. De captivis, 49, 15.
page 373 note 1 Macrobe, Satires, III, 9.
page 374 note 1 On a épilogué sur l'origine du mot servus que nous traduisons par esclave. Certains l'ont rapproché de servari, épargner:Servi ex eo autem appellati sunt quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare et non occidere solent. (FLORENTINUS L. 4 §2. Dig. De statu hominum, 1,15.) L'étymologie est peu vraisemblable. Il est plus simple de le rattacher à servire, servir. Certains (BRÉAL et BAILLY, DARMESTETER, HOVELACQUE) sont d'avis que servus veut dire littéralement gardien et correspond au grec ![]() pour
pour ![]() qu'ils rapprochent du zend «haurvô»:gardien. Cette origine du mot ayant été peu à peu oubliée, servus a signifiné simplement esclave et ce sens est le seul qui soit passé dans les dérivés tels que servio, servitus. Cf. REVON, op. cit., p. 76. — Chose curieuse, le mot « esclave » lui-même était inconnu à Rome;il n'a fait son apparition qu'au Xe siècle, quand les victoires de l'Empereur Othon le Grand sur les Slaves de l'Est de l'Europe ont rendu captifs un grand nombre d'hommes.
qu'ils rapprochent du zend «haurvô»:gardien. Cette origine du mot ayant été peu à peu oubliée, servus a signifiné simplement esclave et ce sens est le seul qui soit passé dans les dérivés tels que servio, servitus. Cf. REVON, op. cit., p. 76. — Chose curieuse, le mot « esclave » lui-même était inconnu à Rome;il n'a fait son apparition qu'au Xe siècle, quand les victoires de l'Empereur Othon le Grand sur les Slaves de l'Est de l'Europe ont rendu captifs un grand nombre d'hommes.
page 375 note 1 L. 17 Dig. 49–15.
page 376 note 1 L. 12 Dig. id.
page 376 note 2 Tite-Live, XXXV–1, XXVIII–46 — Aulu-Gelle, XIII–24.
page 376 note 3 Aulu-Gelle, VI, 4.
page 377 note 1 Valère Maxime, V, 3.
page 378 note 1 Collège religieux composé de dix membres, recrutés par cooptation parmi les grandes families et qui avait pour attribution d'appliquer le jus fetiale concernant la déclaration de guerre, la conclusion des traités, l'extradition, etc.
page 378 note 2 Dion Cassius, Fragments 45.
page 380 note 1 Au début du Ier siècle avant J.-C, les « Alliés », c'est-à-dire les diverses peuplades d'ltalie successivement dominées par Rome, réclamèrent le droit de cité et finirent par l'obtenir après une guerre sanglante (Guerre sociale). Au Ier siècle après J.-C, l'édit de Caracalla rendit citoyens tous les habitants de l'Empire.
page 381 note 1 « C'est la justice et la bonne foi du peuple romain qui l'lont fait paryenir à sa grandeur. » TITE-LIVE, Histoire XLIV, i.
page 381 note 1 De ortu juris civilis I.16.
page 382 note 1 Tite-Live. Histoire, V-21.
page 382 note 2 Tite-Live. Histoire, VIII-13, 14.
page 382 note 3 Cf. Cicéron, De officiis, I, ir.
page 382 note 4 Florus, II, 20.
page 383 note 1 Cité par Buret, Le droit de la guerre chez les Romains, p. 46.
page 383 note 2 Polybe, V, 11 et 12.
page 383 note 3 Appien, Re rebus punicis, 133.
page 383 note 4 Térence, Heautontimorumenos, I, 1, 23.
page 383 note 5 Caritas humani generis. — De finibus, V-23.
page 383 note 6 Cf. de Ligt, La paix créatrice, t. I, p. 208.
page 385 note 1 Lettres à Lucilius, 95, 33.
page 385 note 1 De ira, II, 27.
page 385 note 2 G. Goyau, L'Eglise catholique et le droit des gens, Recueil des cours professés à l'Académie de droit international de La Haye. 6, I, 1925.
page 387 note 1 Marc-Aurèle était fils adoptif d'Antonin le Pieux. Le règne de ce dernier avait été si populaire que ses successeurs prirent le nom d'« Antonins », comme Auguste et ses successeurs avaient pris celui de « Césars ».
page 387 note 2 Voir Chr. L. Lange, Histoire de la doctrine pacifique et de son influence sur le développement du Droit international. Recueil des cours de l'Académie de droit international, 13. Ill, 1926.
page 388 note 1 Institutes, Livre I, titre III, par. 2.




