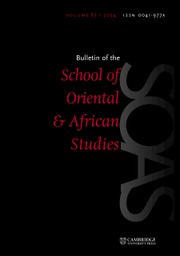No CrossRef data available.
Article contents
Autour d'un texte syriaque inédit sur la religion des Mages
Published online by Cambridge University Press: 24 December 2009
Extract
T A littérature syriaque est jusqu'aujourd'hui trop partiellementéditée pourqu'on puisse songer à en tirer au profit des iranistes une collection complète de Fontes comparable à celles que nous devons à, M. Gray et à M. Clemen pour les sources grecques et latines. II faut se contenter d'enregistrer les textes nouveaux au fur et à mesure de leur découverte et chercher à serrer de plus près les textes déja connus. Le travail a déjà, été amorcé par Gottheil et plus récemment par Nau qui a opéré un dépouillement assez minutieux des Acta Sanctorum publiés par Bedjan mais en dirigeant ses recherches á l'appui d'une thèse fort hasardeuse sur la transmission de l'Avesta.
- Type
- Papers Contributed
- Information
- Bulletin of the School of Oriental and African Studies , Volume 9 , Issue 3 , October 1938 , pp. 587 - 601
- Copyright
- Copyright © School of Oriental and African Studies, University of London 1938
References
page 587 note 1 References to Zoroaster in Syriac and Arabic Literature inClassical Studies in honour of Drisler, Henry, New York, 1894Google Scholar. Sur la question spéciale des Mages de Bethlehem et de la prophétie de Zoroastre sur la venue du Christ, les textes syriaques ont été plusieurs fois rassemblés et examinés. D'autres documents restent á publier Cf. les études du Messina, P.G., S.J. I Magi a Betkmme e una predizkme di Zoroastro, Rome, 1933Google Scholar, et Una presunta profezia di Zoroastro sulla venuta del Messia, Biblica, xiv (1933), 170–198Google Scholar. Voir aussi Herzfeld, , AMI, iv (1932), 106 sqGoogle Scholar. et Rūcker, , Oriens Christianus x-xi (1920–1901), 33 sq.Google Scholar
page 587 note 2 Rev. Hist. Rel. xcv (1927), 149–199Google Scholar et JA. ccxii (1927), 150 sqGoogle Scholar. L'Avesta transmis uniquement par voie orale n'aurait été écrit qu'á partir du VIIe sièele. Les arguments que lui ont opposés les iranistes sont concluants par eux-mêmes, mais on peut montrer par surcroit que le texte syriaque dont il a fait le pivot de sa démonstration peut s'entendre tout autrement qu'il ne le traduit. Jésus Sabran, mage converti dont la vie a été écrite vers 630 (éditée par Chabot, M.J-B., Nlles Archives des Missions scientifiques, vii, 485–584Google Scholar) se met à l'etude des Saintes Écritures. A son pédagogue qui veut commencer par lui enseigner l'alphabet, il demande un enseignement purement oral ‘ parce qu'il était accoutumé à recevoir de bouche la ‘psalmodie’ du magisme, car il n'est pas écrit avec les lettres (ou les signes) de la parole l'enseignement nuisible de Zardušt”. Le texte porte 
![]() ce qu'on peut aussibientraduire par: car l'enseignement pernicieux de Zardušt n'est pas écrit en signes intelligibles, entendons: en écritureque tout le monde puisse lire. Cela peut vouloir dire que vers 580, date approximative de 1'épisode, le souvenir est encore vivant d'un Avesta arsacide de scriptio defectiva, que seuls les doctes savent lire, tandis que les clercs inférieurs apprennent à réciter par cceur, en s';aidant d'un balancement rythmique de tout le corps, selon une méthode qui a pu subsister même après 1'invention de l'alphabet avestique. Nau fait porter la négation de ce membre de phrase sur toute l'expression
ce qu'on peut aussibientraduire par: car l'enseignement pernicieux de Zardušt n'est pas écrit en signes intelligibles, entendons: en écritureque tout le monde puisse lire. Cela peut vouloir dire que vers 580, date approximative de 1'épisode, le souvenir est encore vivant d'un Avesta arsacide de scriptio defectiva, que seuls les doctes savent lire, tandis que les clercs inférieurs apprennent à réciter par cceur, en s';aidant d'un balancement rythmique de tout le corps, selon une méthode qui a pu subsister même après 1'invention de l'alphabet avestique. Nau fait porter la négation de ce membre de phrase sur toute l'expression ![]() laquelle est d'une redondance assez insolite s'il s'agit seulement d'écriture en général. Masudi, Prairies d'Or ii, 123Google Scholar nous dit que pas que le Iivre de Zoroastre est ininteffigible sans l'assistance d'un guide. II ne semble pas que notre auteur ait voulu dire autre chose, et on eonçoit dans ces conditions le développement presque exclusif de l'enseignement oral. Avant les Arabes, les Syriens connaissaient les difficultés spéciales des écritures iraniennes, par exemple 1'existence des idéogrammes sémitiques. Cf. le texte inédit d'Išodad de Merw traduit d'après Vat. Syr. 457 par Vandenhoff, , Oriens Christianus, 1915, p. 237.Google Scholar
laquelle est d'une redondance assez insolite s'il s'agit seulement d'écriture en général. Masudi, Prairies d'Or ii, 123Google Scholar nous dit que pas que le Iivre de Zoroastre est ininteffigible sans l'assistance d'un guide. II ne semble pas que notre auteur ait voulu dire autre chose, et on eonçoit dans ces conditions le développement presque exclusif de l'enseignement oral. Avant les Arabes, les Syriens connaissaient les difficultés spéciales des écritures iraniennes, par exemple 1'existence des idéogrammes sémitiques. Cf. le texte inédit d'Išodad de Merw traduit d'après Vat. Syr. 457 par Vandenhoff, , Oriens Christianus, 1915, p. 237.Google Scholar
page 588 note 1 Studia Syriaca i, pp. 34 sq. (35 du texte syriaque).Google Scholar
page 588 note 2 Sources Syriaques, Leipzig, 1908.Google Scholar
page 588 note3 Nous tenons à remercier M. Brière de nous l'avoir obligeamment communiqué et de nous avoir fait bénéficier de son érudition et de ses conseils. Le M s de N.D. des Semences dérive de celui de Mossoul (qui est date de 1874–5) et est le modele de Vat. Syr. 497 décrit par le Vosté, P., Manuscrits syro-chaldéens récemment acquis par la bibliothèque vaticane in Angelicum vi (1929), p. 34Google Scholar, qui vient s'ajouter avec un Ms de la Collection Mingana à la liste donnée par Baumstark. Le P. Vosté a découvert un autre traité de Jean bar Penkayē, le Livre du Commerçant, dont le titre seul était connu par le Catalogue d'Abdišo. Cf. Recueil d'auteurs ascétigues nestoriens, ibid., p. 204. xxxiii.
page 590 note 1 Nyberg, H.S.. Questions de Cosmogonie et de Cosmologie mazdiéennes. JA. 1929, 193–310Google Scholar; 1931, 1–134 et 193–244. Benveniste, E.. Le Témoignage, de Théodore bar Konay sur le Zoroastrisme, MO., 1932.Google Scholar
page 591 note 1 Cf. Nyberg, , op. cit. (1929), 238–241Google Scholaret PO. iv, p. 319.Google Scholar
page 591 note 2 Dans la tradition iranienne les créatures ont une odeur bonne ou mauvaise selon leur vertu ou le principe dont elles dérivent et 1'épithéte qui désigne le mauvais ménōk, gandak, peut, selon M. Nyberg, représenter un ancien gandalc, puant < mauvais. Dans le récit de la Genèse, ch. xvii, Isaac aveugle croit reconnaître Esaü a 1'odeur de ses vêtements qu'a revêtus Jacob. Chez Eznik, Zurvan commence par refuser de reconnaître Ahriman pour son fils parce qu'il n'est pas parfumé et lumineux, et quand il se résigne à assigner un terme à sa domination, e'est que, comme Isaac, il ne veut pas revenir sur sa parole.
page 591 note 3 Cp. par exemple Šv. vii, 14–32; viii, 50–1: Pas šayat dānastan ku čim vahạnạ yas kunišnạ ạ yak āinaa zyan yaš ež hamēstār, u vazūdār, i ež be šāyat būdan, spuxtan awaž dāštan i xvat čim u vahan i dạm dahišni. II faut savoir que l'un des motifs qui sont cause de l'action est de repousser et de rejeter le dommage qui vient de Tadversaire et du destructeur [lequel est, nécessairement, extérieur]; et c'est là le motif et la cause de la création.’ Cf. aussi, GBd Ank., p. 4.Google Scholar
page 591 note 4 Ainsi dans les Actes de Pethion, Bedj. ii, 578, on raconte comment Ormuzd, pour récupérer les eaux que lui ravit Ahriman recourt, à l'instigation d'un démon, à l'action de diverses créatures ahrimaniennes, la grenouille, le moucheron. La légende, dont on n'identifie pas tous les détails, porte la marque d'un récit tout populaire.
page 593 note 1 Compte tenu de l'incontestable influence de certaines manieres de penser indiennes sur l'esprit et la terminologie de cet ouvrage.
page 593 note 1 Bedj. ii, 450 sq. Le même texte a été édité deux fois en 1890, par Feige et par Abbeloos.
page 593 note 2 Bedj., Histoire de Mar Jabalaha, p. 528Google Scholar; Hoffmann, , Auszüge aue syrischen Akten Persischer Märtyrer, p. 109Google Scholar; Braun, , Ausgewählte Akten Persischer Märtyrer, 263.Google Scholar
page 593 note3 Outre lea textes rassemblés par West, Pahlavi Texts ii, voir Inostrantzev (trad, angl. de Bogdanov) dans le Journal of the Cama Oriental Institute n° 7 et les indications bibliographiques.
page 593 note 4 Bedj. ii, 592. Je ne pense pas qu'on puisse alléguer les textes manichéens où Jésus est á la fois Pére et Mére des miséricordes, Pére qui precède du Père et Mère vivifiante (cf. Waldschmidt-Lentz, , Die Stettung Jesu im Manichäismus, pp. 37, 124)Google Scholar. II est peu probable que les chrétiens aient affecté de prendre à la lettre pour en faire un objet de dérision un langage qu'on pourrait retrouver chez les Peres de l'Eglise.
page 593 note 5 Xuastanift i, 3.
page 593 note 6 Bedj. ibid.
page 593 note 7 Langlois, p. 381.
page 594 note 1 Bedj. ii, 578. Le sens exige qu'on mette un point après ‘lumineux,’ contrairement au texte de Bedjan suivi par Nöldecke et Nau.
page 594 note 2 Pahlavi Rivāyat ch. viii (ed. Dhabhar, , p. 16Google Scholar): “ U paitāk ku fratōm bar ka.š nazdīk šavēt 1000 dēv bē mīrēt u 2000 yātūk parīk; kē.š 2 bār bē nazdīk savēt 2000 dēv bē mīrēt 4000 yātūk parīk; ka 3 bār bē ō nazdīk šavēt 3000 dēv be mirēt 6000 yātūk parik ; ka.š 4 bār bē ō nazdīk šavēt aškárak ahraβ bāvēt mart u žan”: “La première fois qu'il y a commerce charnel, 1000 devs meurent et 2000 sorciers et péris; quand cela a lieu deux fois, 2000 devs meurent et 4000 sorciers et péris; trois fois, 3000 devs et 6000 sorciers et péris; quatre fois, l'homme et la femme deviennent des ‘;justes”; d'une façon publique et consacrée.”
page 595 note 1 Le texte a d'abord été publié isolément par Brann, ZDMG., 1903, avant de prendre place dans Sachau, Syrische Sechhbücher iii, 265.
page 595 note 2 Sachau, op. cit. ii (Timothée, §§ 19, 25; Jesus Bar Nun, section 119); Chabot, , Synodicon Orientate, pp. 150 (410); 82 (335)Google Scholar. Nau, , Une ordonnance de Mar Aba, in Le Canoniste Contemporain xxiiie an. 1900, pp. 20–7.Google Scholar
page 596 note 1 Cf. Cumont, . Les unions entre proches à Doura et chez les Perses, CR Ac. Inscr. 1924, pp. 53–62. “ Darmesteter dans l'étude qu'il a eonsacrée au Khetuk das comme l'appellent les Parsis, aboutit à la conclusion que cette pratique n'a probablement été que celle d'une minorité. Le droit à l'inceste, dit-il, n'a jamais du etre que le droit de très nobles ou de très saints. Les inscriptions de Doura nous prouvent qu'aumoins le mariage entre frères et soeurs consanguins était en usage en dehors des families princières ou sacerdotales, et beaucoup plus répandu que ne le croyait l'eminent traducteur de l'Avesta.” M. Cumont souligne aussi, à propos du Livre des lois des Pays de Bardesane, que, si la polémique contre l'astrologie dérive de Carnéade, “ce livre écrit à Edesse n'eut pas rapporté ce trait caractéristique des moeurs perses, s'il n'avait été vrai de son temps.”Google Scholar
page 596 note 2 Bedj. Histoire …, p. 437 sq.
page 596 note 3 Scheil, V.. La vie de Mar Benjamin. Texte syriaque in Zeitschrift fur Assyr. xii, p. 68Google Scholar. Trad. ROC, ii (1897), p. 245 sq.Google Scholar
page 596 note 4 Mingana, , Sources, p. 36Google Scholar. La discussion se poursuit au sujet de la valeur historique de la “Chronique d'Arbèle ”. Contre: I. Ortiz de Urbina. S.J., Intorno al valore storico della cronaca di Arbela, in Orientalia Christiana Periodica, ii (1936), pp. 1–32 et Storia e cause dello scisma della chiesa di Persia, ibid., iii (1937), pp. 456–485. Entre temps, en sens contraire, une note de Messina, G. in Orientalia vi (1938), pp. 235–6.Google Scholar II serait tentant de faire état de ce que le chroniqueur nous dit de la réforme religieuse d'Ardašir: il ordonna de construire de nouveaux pyrées pour que le soleil, dieu suprème de 1'univers recut un culte spécial; prit le premier le titre de roi des rois et de dieu, enfin, ce qui nous interesse ici, “ il intégra et annexa au culte du soleil et du feu un grand nombre d'autres religions ” (p. 31).
page 596 note 5 Chron. Eccles. ed. Abbeloos, ii, 24Google Scholar. Le nom se trouve aussi à plusieurs reprises dans le Talmud. Le Wörterbuch de J. Levy renvoie à Hullin, 133b; et à Kidduśim, 65b.
page 597 note 1 Cf. Waldsehmidt-Lentz, . Op. cit., p. 59.Google Scholar
page 597 note 2 Amm. Marc, xxiii, 6; xvii, 5. Rex regum Sapor, particeps siderum, frater solis et lunae … Cp. Bedj. ii, 161, 322, 577. Patr. Syr. ii, Acta Simonis § 24.
page 597 note 3 C'est la un élément très important d'un vaste problème dont Christensen, M. a traité longuement certains aspects; L'Iran sous les Sassanides, 1937 et Les gestes des rois dans les traditions de l'Iran antique, 1936. II vaudrait la peine de rassembler tous les textes du Denkart sur les rapports de la royauté et de la religion. Parmiles textes syriaques le plus intéressant sur ce point est celui des Actes de Péthion traduit par Noldecke et par Nau (Bedj. 575 sq.) où se trouve indiquée la correspondance entre ce monde visible et le monde de l'au dela, entre I'honneur recu en ce monde (la faveur royale) et la gloire recue dans 1'autre. II serait très profitable de marquer ce qui distingue la conception iranienne de la royauté de la conception romaine (ou orientale) du culte impérial et, l'une et 1'autre, de la notion chrétienne de l'autorité du pouvoir légitime déja nettement formulée dès les premières persécutions.Google Scholar
page 597 note 4 J'emprunte ces données au P. I. Ortiz de Urbina. Die Ootthe.it Christi bei Aphrahat, Rome, 1933, pp. 42–7.Google Scholar
page 598 note 1 Cp. l'argument Giwargis, de, Bedj. Histoire, pp. 528–9Google Scholar: le feu est caché dans la pierre ou le bois dont on le tire par frottement et n'est adoré des mages que lorsqu'ils l'ont eux-mêmes produit; mais il est si dépourvu d'intelligence qu'il brule indiffereraent tous ceux qui s'en approchent sans épargner le mage qui 1'alimente. Dans S. Ephrem, Prose Refutations, ed. Mitchell, i, 104 = lxxx; ii, 99 = xlv; 174 = Ixxxii. Kardagh objecte, que si le soleil est intelligent, il doit proportionner sa chaleur de maniére à modérer les différents climats Bedj. ii, 452 (cp. une idée analogue dans S. Ephrem, ibid., ii, 211–12 = c); les astres, s'ils sont vivants, devraient être sujets à la fatigue Bedj. ibid. S. Ephrem, ibid., ii, 198–9 = xciv. D'une facon générate, c'est la manière même de poser l'objeetion qui est identique: si Bardesane ici, le magisme là, en décemant aux astres et aux éléments le nom d'ousiai ![]() , entend nier que ce soient des créatures
, entend nier que ce soient des créatures ![]() c'est qu'il en fait des dieux; pour le chrétien, l'incréé, le divin, s'identifie avec Dieu et il n'y a qu'un Dieu. Le mazdéen consent a une certaine hierarchie dans le divin.
c'est qu'il en fait des dieux; pour le chrétien, l'incréé, le divin, s'identifie avec Dieu et il n'y a qu'un Dieu. Le mazdéen consent a une certaine hierarchie dans le divin.
page 598 note 2 Hymn, iii, 7 Contre les Fausses Doctrines, ed. rom. Op. Syr., ii, p. 444. Trad, allem. par Rücker, Bibl. Kirch. Väter, 61 (1928).
page 598 note 3 Cf. les travaux de Schaeder, H.H.. Bardesanes von Edessa in der Überlieferung der griechischen und der syrischen Kirche, in Z. fur Kirchengeschichte Ii (1932), pp. 21–73Google Scholar et de von Wesendonck, O.G.Bardesanes und Mani in Acta Orientalia x, (1932) pp. 336–363Google Scholar. Le point de départ nouveau des recherches bardesaniennes est l'édition des Prose Refutations de S. Ephrem publiées par Mitchell (avec les notes de Bevanet de Burkitt), 1912–1921. Peut-être des precédés plus modernes permettraientils de compléter la lecture du palimpseste.
page 598 note 4 Contre Julien, iv, 10 (ed. Overbeck, 1865; trad. Euringer, BKV., 37 (1919)Google Scholar, i, 30; iii, 17).
page 599 note 1 Cf. Assemani, . Acla Marl. Orient., i. 228. “ Ne savez-vous pas, dit le roi aux chrétiens en les exhortant, que je suis de la race des dieux et cependant j'adore le soleil et je vénère le feu.”Google Scholar
page 599 note 2 Bedj. ii, pp. 208 sq. Braun, p. 67.
page 599 note 3 Dans ses notes sur les Yezidis, JRAS., 1916Google Scholar, et 1921, Mingana avait signalé des allusions au culte de Tammuz dans les textes encore inédits de Jean bar Penkaye; elles devaient prouver la survivance jnsqu'au VIIe siècle de ce culte oú Mingana voyait l'antécédent du culte du paon chez les Yezidis, Melek Taus étant à ses yeux une corruption du nom de Tammuz. M. Furlani s'est montré très sceptique avant même la publication des textes annoncés (Testi Religiosi dei Yezidi, Bologne, 1930Google Scholar). Je ne vois pas qu'on puisse tirer grand chose de notre passage ni de celui que je donne ici: Ms. Pognon t. i, pp. 208–210.

“L'un adore le soleil, l'autre la lune, un autre telle d'entre les étoiles; certains sacrifient aux idoles, d'autres aux bêtes. Les Chaldéens adorent les étoiles, et certains d'entre eux disaient que le monde a été fait et mis en mouvement par les anges. Les Perses adoraient le soleil et le feu, d'autres, la lune; les Egyptiens, l'ail et les oignons les singes eu les bêtes et les reptiles. IIs en faisaient des dieux. D'autres (adoraient) un démon appelé Balšemin; d'autres Balzebub; les Arabes, la chevre (s'agirait-il de la tribu arabe des Anzah ?); d'autres Baal; d'autres Tammuza; d'autres un monstre marin, comme chez les Babyloniens…. L'un pensait que le monde vient de lui-meme, d'autres qu'il provient de plusieurs ousiai; pour les uns, du bien et dumal; pour les autres Hormizd et Ahrman; par d'autres furent introduits les sorts, signes du zodiaque, horoscopes, etc.”
M. Furlani a bien mis en lumière le rôle des légendes musulmanes où le paon est mis en liaison avec le démon. Pour autant, l'influence iranienne n'est pas exclue. On peut citer ce texte d'Eznik: Les mages “ disent egalement une autre chose qu'Arhmn aurait exprimée: Ce n'est pas que je n'aie point le pouvoir de faire quelque chose de bien, mais je ne le veux pas! ” Langlois, , ii, p. 380.Google Scholar