No CrossRef data available.
Article contents
Un coup d'œil sur la vulgarization
Published online by Cambridge University Press: 26 July 2017
Abstract
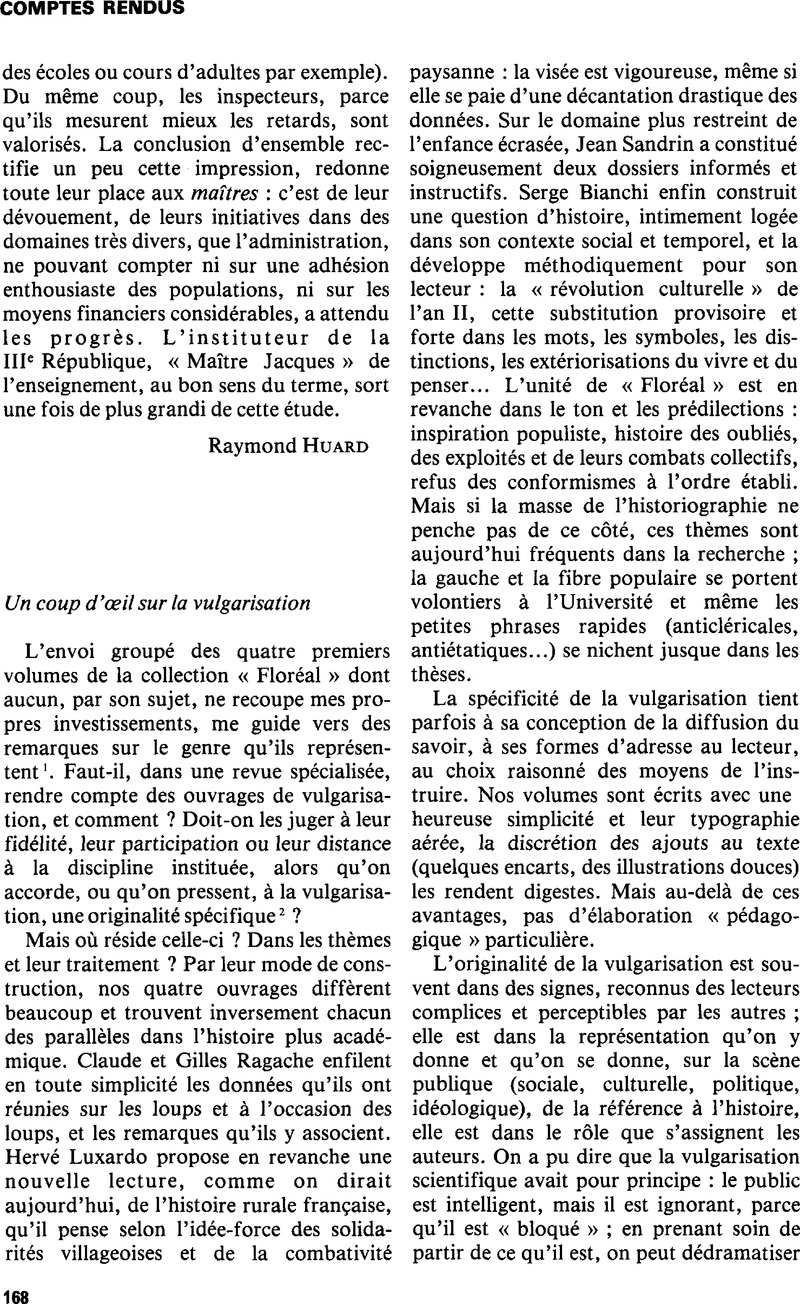
- Type
- Éducation et culture (comptes rendus)
- Information
- Copyright
- Copyright © Copyright © Les Éditions de l’EHESS 1984
References
1. Claude-Catherine, et Ragache, Gilles, Les Loups en France. Légendes et réalité, Paris, Aubier-Montaigne, « Floréal », 1981, 255 pGoogle Scholar. Hervé Luxardo, Les Paysans. Les républiques villageoises (Xe-XIXe siècles), ibid., 1981, 253 p. Jean Sandrin, Enfants trouvés, enfants ouvriers (XVIIe-XIXesiècle), ibid., 1982, 255 p. Serge Bianchi, La Révolution culturelle de l'an II. Élites et peuple 1789-1799, ibid., 1982, 303 p.
2. J'importe ici le mot de vulgarisation, que « Floréal » ne revendique pas. Son emploi n'est pas uniforme. Vulgarisation ne s'oppose pas pleinement ni régulièrement à « œuvre de première main » — qui peut d'ailleurs être telle selon plusieurs critères. En 1927 pourtant, Lucien Febvre présentait son Martin Luther comme un travail de vulgarisation et de réflexion ! Le public que, par définition, la vulgarisation suppose peut commencer aux étudiants en histoire, mais on le pense plus large et peu spécifié le plus souvent. C'est, enfin, le succès d'un livre plus que l'intention précise de l'auteur qui peut le faire ranger sous cette enseigne.
3. Ces trois formules ne sont données, bien sûr, que comme un schéma de commodité provisoire ; approximatif, il laisse aussi beaucoup d'œuvres hors de ses prises. Il rappelle au moins qu'en écrivant « pour le public », des auteurs pensent surtout, selon le cas, qu'ils écrivent pour des lecteurs autres, ou qu'ils écrivent autrement la même histoire, ou qu'ils écrivent une autre histoire. Mais certains historiens écrivent tout simplement comme à l'accoutumée, et d'autres, qui ne sont pas universitaires, n'ont jamais écrit que pour le public.
4. L'écartèlement n'est pas vraiment douloureux : le livre de Serge Bianchi, pleinement à sa place dans « Floréal », est aussi de facture très universitaire, pour son bien dans les deux cas.




